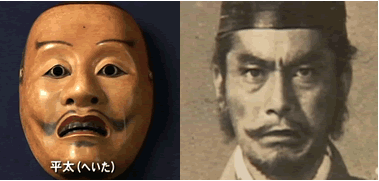jeudi 30 juillet 2009
12 hommes en colère (12 angry men)
Imaginez qu’un film soit une véritable leçon de cinéma. Ici par exemple, le génie de Lumet consiste à faire tenir la route à un récit durant 1h30 en ne contenant qu’un décor unique, 12 acteurs et une suite ininterrompue de dialogues. Ce pari fou ne semble poser aucun problème à Lumet, lequel parvient par je ne sais quel miracle à créer non seulement l’ambiance tendue qu’il faut tout en évitant d’asphyxier son film et de le rendre plan-plan (les différents cadrages sont très nombreux). Aucune faute d’axe, aucun problème de raccords, rien : le film est tout simplement abouti sur le plan technique. Plus fort encore, Lumet parvient même à recréer, par les dialogues et quelques éléments de mise en scène (un détail, une reconstitution entre jurés) un procès dont nous ne savons rien et que nous n’avons pas vu !
Imaginez aussi qu’un film, un premier qui plus est, contienne tous les éléments d’une œuvre longue et riche à venir. Car dans 12 hommes en colère, c’est bien le cinéma entier de Lumet qui prend place : la réflexion sur le système judiciaire défaillant, la sobriété et l’efficacité d’une mise en scène au service du scénario, un art de l’ambiance tendue, une direction d’acteurs hors pair (car, comme si j’avais besoin de le dire, Henry Fonda est merveilleux, mais les autres acteurs aussi).
Imaginez enfin que, sous ces airs de film standard pour grand public, se cache un message, un cri d’opinion de la part d’un cinéaste très engagé. Car ce n’est pas tant la délibération et les débats qui en découlent qui intéressent Lumet mais bel et bien son opposition à la peine de mort, trop souvent appliquée à des affaires bâclées ou souffrant (comme ici) de jurés incompétents (au choix ceux qui s’en moquent, les opportunistes, les racistes ou les vengeances personnelles).
Si vous parvenez à imaginer cela, vous comprenez le sens du mot chef-d’œuvre. Et si vous n’y arrivez pas, eh bien regarder 12 hommes en colère, tout simplement.
Note : *****
Publié par Bastien à 14:38 0 commentaires
Libellés : *****, Années 1950, Lumet Sidney
mardi 28 juillet 2009
Ghostbusters
J’avais le souvenir d’un Ghostbusters très drôles, plein de fantômes et d’action, et une fâcheuse tendance à mélanger les deux histoires. J'ai revu un film qui a pris un p’tit coup de vieux, drôle mais pas hilarant, avec 3 fantômes à l'heure et un final drôlement vite expédié.
Il demeure néanmoins que le film possède un petit charme indéniable, ce petit charme propre aux productions audacieuses des années 80, années des films cultes par excellence. De plus, il y a quand même un casting intéressant : Dan Aykroyd, un irrésistible Bill Murray, Sigourney Weaver…
Tiens, en parlant de Sigourney Weaver, elle illustre à elle seule le principe même du film : rire de l’horreur. Comme Gremlins à la même époque, Ghostbusters s’amuse à détourner les figures du cinéma de frissons pour s’en amuser. Weaver, à jamais associée à Alien, est ici une pauvre fille qui ne sait pas se défendre ; les fantômes ne s’amusent qu’à déranger une bibliothèque ou bouffer les repas d’un hôtel ; même le grand méchant est d’abord une femme avant de devenir… Bibendum Shamallow ! Du n’importe quoi, du second degré qui a sans doute permis au film justement de cartonner au box-office et d’hanter si souvent le petit écran pour la joie des petits et grands.
Who ya gonna call ? GHOSTBUSTERS !
Note : ***
Publié par Bastien à 15:35 0 commentaires
Libellés : ***, Années 1980
dimanche 26 juillet 2009
Panique au village
A l’origine, une série de courts métrages tous plus absurdement drôles les uns que les autres (voir Le déjeuner sur l’herbe, La course cycliste, Laurent ou mon préféré Lise et Jan) dont l’adaptation en long métrage s’est faite attendre dans une drôle d’ambiance (passer de 5 minutes à plus d’une heure, pari risqué). Evidemment, le concept est suffisamment loufoque pour tenir la route ! Probablement le plus belge des films belges de cette décennie (tant par l’humour que par les accents bien prononcés), Panique au Village regorge d'humour loufoque voir absurde, d'inventivité, d'audace, de personnalité.
C'est une animation bancale (mouvements hachés et peu fluides) qui s'assume, mieux qui en tire parti pour faire de ce côté bricolé, assemblage de plastique et de carton peint, un fantastique voyage vers notre enfance, lorsque l'on jouait avec ces figurines et que, nous aussi, on leur inventait des histoires farfelues. La grande force du concept réside en effet dans ce côté universel, ce renvoi au passé de chaque spectateur qui a un jour eu ces figurines standard des cow-boys, indiens, fermiers, chevaux et autres animaux de la ferme. Les voix collent parfaitement aux personnages, et les accents belges savamment exagérés rendent ce film très attachant, toujours bon enfant.
Panique au village, si on devait résumer, ce serait 1h10 de bonheur décomplexé. A réserver aux amateurs du style néanmoins (si vous ne tenez pas plus de 10 minutes pour les courts métrages, passez votre chemin) mais quand on adhère, ce n’est que du bonheur !
Note : ****
Publié par Bastien à 16:57 0 commentaires
Libellés : ****, Animation, Années 2000
vendredi 24 juillet 2009
Landru
J’avoue ne pas connaître l’œuvre de Chabrol, peut-être suis-je donc passé à côté de certaines choses. Il n’empêche que Landru m’a semblé une œuvre à part, décalée et bien plus subtile qu’elle n’y paraît.
Il y a déjà, de la part de Chabrol et de Françoise Sagan (auteur du scénario) une volonté d’humaniser Landru peu commune aux autres films de l’époque parlant de meurtriers. Si Chaplin voyait en Landru-Verdoux une victime de la crise économique, Chabrol lui voit en Landru une victime de la Guerre, obligé de tuer pour survivre, même si ce travail le dégoûtait. Chabrol ne défend pour autant pas son personnage, qui tue trop froidement pour être lui-même une victime. Cette ambiguïté, ce refus de juger l’homme est, pour l’époque, admirable.
Il y a aussi chez Chabrol une volonté de distanciation constante en fondant sa mise en scène sur le côté théâtral : de par le cadrage, parfois, de par les costumes, aussi, de par l’exagération, souvent. A ce titre, le procès et l’exécution de Landru sont des grands moments théâtraux.
Enfin, comment parler de ce film sans parler de l’immense interprétation de Charles Denner, méconnaissable, s’effaçant totalement derrière le crâne dégarni et la longue barbe du criminel.
Une œuvre surprenante donc, non pas sans longueurs et baisse de rythme mais avec assez de subtilité et d’humour plus que cynique pour tenir tout du long.
Note : ***
Publié par Bastien à 23:40 0 commentaires
Libellés : ***, Années 1960, Chabrol Claude
mercredi 22 juillet 2009
OSS 117 - Rio ne répond plus
Ici on reprend les même et on recommence : des blagues sur les Juifs au lieu des Musulmans, des nazis, une collaboratrice féministe avec qui OSS ne fait que des impairs... Comme pour ne pas se fouler (ou équilibrer les moqueries qui n’en sont pas réellement ?), Hazanavicius fait le minimum syndical et mise tout sur une recette qui avait effectivement fait ses preuves, mais qu’il aurait tout de même été de bon ton, après 3 années de préparation, de modifier pour attirer encore plus de public plutôt que de miser uniquement sur celui déjà conquis.
Ce que je trouve dommage, c'est la perte du fil conducteur du film : dans le premier, il s'agissait autant d'un hommage que d'une parodie des films d'espionnage des années 40 (notamment Casablanca) ; ici, si la première demi-heure est effectivement bourrée de clins d’œil aux films des années 60 (l'utilisation abusive du split-screen, les musiques yéyés) mais on vire rapidement dans la comédie pure, sauf que les gags sont parfois drôles, souvent lourds, constamment tirés en longueur (les Chinois, l’Américain). Il n'y a plus ce sens du rythme qui faisait passer le premier comme une lettre à la poste. Si le premier parodiait les premiers OSS 117, celui-ci aurait pu allégrement se moquer des James Bond période Terence Young mais il n’en est rien.
Reste quand même quelques moments assez drôles et un Jean Dujardin qui a la classe. Ca fait peu quand même.
Note : **
Publié par Bastien à 17:17 0 commentaires
Libellés : **, Années 2000, Hazanavicius Michel
lundi 20 juillet 2009
Double feature cinéma
Bon, c'est clair, c'est pas le chef-d’œuvre du siècle ou du genre. Mais ce petit film sympathique, mine de rien, est un formidable tremplin à l'immense talent de Kevin Spacey, qui compose ici un producteur infâme et pourtant touchant. Face à lui, le reste du casting semble bien pale, surtout Frank Whaley alors qu'il est quand même l'acteur principal. Mais le jeu de Spacey est tel, et le twist final est si réussi, qu'on accepte les défauts d'une réalisation souvent convenue, d'une musique horripilante et d'un casting bancal. Et puis, quelle joie de voir Hollywood se faire mordre de cette belle façon encore une fois !
Note : ***
Citizen Welles (RKO 281)
RKO 281 (c'était le nom officiel du tournage de Citizen Kane) est un film sincère, documenté, qui hélas ne décolle vraiment jamais. En dépit d'un casting magnifique, dominé par Malkovich et Cromwell (Schreiber, hélas, manque un peu de puissance pour incarner Welles himself, même s'il se défend bien). Une fois n'est pas coutume, on regrettera que le film ne soit pas plus long, n'a pas plus en profondeur concernant Welles lui-même et l'époque difficile dans lequel Kane est né. Les fans s'amuseront et les néophytes apprendront des choses. Après tout, mission réussie.
Note : ***
Publié par Bastien à 11:01 0 commentaires
Libellés : ***, Années 1990, Années 2000
samedi 18 juillet 2009
Mystery Train
Premier wagon. Première histoire. Un couple de jeunes japonais, désabusés (rappelant ceux de Contes cruels de la jeunesse d’Oshima), qui errent sans véritable but, et sans savoir réellement se parler : un couple antonionien dans la plus pure tradition. Le décor est celui pourri d’une Amérique en perdition, une Amérique de laissés pour compte, ici Memphis qui n’a pour seul intérêt que d’être la ville du King. Un premier segment fascinant, décalé, où Jarmusch parle encore et toujours du choc culturel. Et démontre qu’il est aussi à l’aise dans la couleur que dans le noir et blanc.
Deuxième récit. Une rencontre : Nicoletta Braschi, qui ramène celui qui pourrait être Bob de Down by Law, et une jeune fille déboussolée qui vient de larguer son boyfriend qui ressemble à Elvis. Plus angoissant : la fille se sent seule et en insécurité dans un bled peuplé de dingues. Plus fantastique : Elvis apparaît, s’excuse du dérangement et s’en va. Un segment plus mou, moins séduisant, mais tout aussi intéressant.
Dernière partie. La plus jarmuschienne : que des loosers, des paumés, dont un mec qui ressemble à Elvis et vient de se faire larguer. Personne n'a autant de passion pour les déclassés, les marginaux, et les filme si bien. Drôle, parfois surréaliste, complémentaire des deux autres parties. Réussite totale.
Pour lier le tout, la musique : au centre, Elvis Presley, et tout autour Rufus Thomas (soul man, accueille les jeunes japonais), Joe Strummer (chanteur des Clash, sosie d’Elvis) qui tire le coup de feu qui relie chaque segment, Screamin Jay Hawkins (dandy de l’hôtel qui accueille les personnages) et la voix de Tom Waits qui souhaite la bonne nuit au son de Blue Moon.
Le train redémarre. L’arrêt n’aura duré qu’une nuit. Une nuit sur terre. Une nuit comme tant d’autres ? Pas sûr.
It was a really mystery train.
Note : ****
Publié par Bastien à 17:10 0 commentaires
Libellés : ****, Années 1980, Jarmusch Jim
jeudi 16 juillet 2009
Nous ne vieillirons pas ensemble

Le film qui révéla Pialat au grand public, son deuxième, et quelle claque !
Fort de sa première expérience, Pialat ne commet plus les légères erreurs de l’Enfance nue (choisir des amateurs pour des rôles difficiles) et opte pour un film posé, avec des vedettes et un scénario correctement construit. Sans plans inutiles, sans lourdeur de récit, le film aborde la séparation à petit feu d'un couple qui s'aime sans s'aimer, et qui finira par se détester sans se détester. L’amour impossible, l’amour vache, l’amour gâché, un des grands thèmes de Pialat qui trouve ici un écho qui n’aura d’égal, à mes yeux, que celui de A nos amours. Pialat ne croyait certainement en l’amour, mais il l’imaginait mal : le titre du film, Nous ne vieillirons pas ensemble, outre son audace de ruiner le suspens du film, souligne bien la vision pessimiste du réalisateur.
Le côté biographique est évident (il sera de notoriété publique que l’histoire est authentique, Pialat ayant vécu une histoire avec une jeune fille qui s’est mal terminée), ne serait-ce déjà que dans le personnage de Yanne, proche psychologiquement mais aussi un peu physiquement (je trouve) du cinéaste. L’acteur livre par ailleurs une performance remarquable. Drôle sans réellement l’être (il est quand même odieux, mais ça reste Jean Yanne), il capte littéralement l’attention, impose sa présence à l’écran, le tout avec une justesse et une fraîcheur peu commune (il faut dire qu’il improvisait beaucoup). Face a lui, Marlène Jobert, fragile, innocente, est aussi parfaite.
Avec un tel duo d’acteurs, Pialat ne pouvait que mettre sa caméra à leur service, et le fait en privilégiant le plan-séquence au montage avec beaucoup de plans. L’autre avantage c’est que, de la sorte, on continue à garder à l’esprit ce côté « documentaire », captation d’un fragment de la vie de tous les jours. Cet aspect confère une apparente austérité qui est trompeuse, le film dégageant une puissance, une émotion qui ne laissera personne indifférent.
Du très grand art.
Note : ****
Publié par Bastien à 11:25 0 commentaires
Libellés : ****, Années 1970, Pialat Maurice
mardi 14 juillet 2009
Los Angeles 2013 (Escape from L.A.)
Snake Plissken, tout juste arrêté, est envoyé de force chercher une chose très importante dans la dite ville. Il n’a pas le choix : s’il n’y va pas, le virus qu’on lui a injecté le tuera.
Arrivé là-bas, c’est Mad Max en plein : tout le monde butte tout le monde pour un oui ou pour un nom, et divers gangs se sont formés en fonction des quartiers. Après quelques péripéties, au cours desquelles il rencontre un drôle de gars et des femmes fatales, il arrive chez l’ennemi, qui le capture et le force à pratiquer un jeu mortel. Evidemment, Snake réussit à survivre et s’évade.
Bon je passe les détails, c’est la guérilla urbaine, ça tire dans tous les sens et on compte les morts par dizaines, mais Snake réussit à revenir près de mister President avec ce qu’il voulait, juste avant de lui jouer un tour de cochon en guise de twist final.
Vous pensez que je parle de New York 1997 ? Raté, c’est bel et bien de Los Angeles 2013 qu’il est question. Une pâle copie juste un peu plus thunée que son prédécesseur, même si les effets spéciaux ont très mal vieillis. Le casting est encore 5 étoiles, et il y a des moments très funs (le « petit Bangkok », le surf, l’attaque des deltaplanes) mais dans l’ensemble, cela sent le déjà vu, pire le déjà vu par des vieux. Le charme de New York 1997 n’est plus là dans cette suite uniquement commerciale. Même la musique se copie elle-même, Carpenter semblant vraiment être à court d’idées.
Reste qu’en tant que fan de Carpenter, je ne peux décemment pas descendre ce film, qui je le dis comporte de grands moments. Mais ce même statut de fan ne peut que me pousser à vous diriger, si vous avez à choisir, vers New York 1997 et oublier ce film-ci.
Note : **
Publié par Bastien à 23:19 1 commentaires
Libellés : **, Années 1990, Carpenter John
dimanche 12 juillet 2009
Vengeance
Visuellement, To est définitivement un maître : les séquences de gunfights (deux en particulier : celle dans le parc la nuit et celle digne de Fort Alamo dans une décharge, la finale étant un peu plus convenue) comme les moments plus atypiques (cfr la bicyclette qui roule toute seule… enfin, avec l’aide des balles qui ricochent sur elle) sont grandioses.
Mais premier problème : pour moi, Johnny n'est pas un acteur, il se fait aplatir même par les enfants dans ce film. Pour jouer les perturbés, il ne suffit pas d'avoir le regard vide ! Il a une gueule, sans aucun doute, mais ça ne fait pas tout : malgré tout le respect que j’ai pour Johnnie To, il n’est pas Sergio Leone. Et tant qu'à critiquer, quid de Sylvie Testud ? N’importe quelle autre actrice aurait fait l’affaire ! Mais l’association Halliday-Testud n’aurait-elle pas pour but de rallier à sa cause les spectateurs moyens et les plus connaisseurs ? D’autant que face à lui, les habitués de To qui, comme d’hab, sont irréprochables : le ténébreux Gordon Lam, l’irrésistible Lam Suet, l’impressionnant Anthony Wong et l’infâme Simon Yam. Autant dire que, d’un seul regard, ils bouffent le meilleur moment d’Halliday…
Quant au scénario, grosse déception : le film regorge de bases intéressantes (la notion de vengeance et d'oubli, un étranger dans une culture qu'il ne connaît pas...) que To aurait pu magnifier mais qu'il préfère survoler. Et si quelques effets sont sympas (comment Costello doit reconnaître sa cible à la fin), si les thèmes de To sont bien présents (l’idée de clan, la dualité, la compétition, le sens de l’honneur, l’importance du hasard…), il y a tout de même pas mal d'incohérences (genre Costello qui oublie ses ennemis, mais sait que les 3 autres sont ses potes, ou encore qu'il oublie la signification du mot "venger" mais qu'il parle toujours anglais). Un ami m'a dit qu'on ne pouvait pas tout cerner dans ce film, car on a pas la même base culturelle. Peut-être certaines subtilités m'échappent-elles mais bon, faut arrêter, le film est produit par des français visiblement pour un public occidental !
Bref un film mineur, To semblant se décarcasser en mise en scène alors que Wai Ka Fai fait semblant de compliquer un scénario somme toute prévisible. Reste que dans le domaine du divertissement pur, car je me refuse de voir ce film comme une œuvre personnelle, c'est du haut niveau.
Note : ***
Publié par Bastien à 00:23 0 commentaires
Libellés : ***, Années 2000, To Johnnie
vendredi 10 juillet 2009
Synecdoche, New York
L'histoire d'un hypocondriaque qui flingue sa vie pensant qu'il va mourir (ce qu'il ne fait pas... ou si ? Et si tout n’était qu’un rêve de mourrant ?) et qui suite à une bourse pour monter une pièce veut retranscrire la vie, sa vie... Absolument dingue ! Je défie quiconque de trouver une vraie logique dans ce film, qui mélange réalité, fiction et réalité fictionnelle (?). C'est un drame comique, c'est une comédie dramatique, il y a autant de désespoir dans le comique que de comique dans le désespoir (?). On pense parfois à Adaptation. et on se dit que ce dernier était d’une simplicité déconcertante en comparaison à celui-ci.
C’est l’histoire d’un jeune cinéphile qui écrit sur ce film. Pour bien comprendre ce dernier il décide de s’y plonger corps et âme. Et de se dire que Philip Seymour Hoffman est, comme a chaque fois, incroyable, réussissant comme toujours à effacer son statut d’acteur et à exister en tant que personnage, à se faire oublier dans la mimesis et à exister en tant que personnage de fiction.
C’est l’histoire d’un jeune cinéphile qui écrit sur un jeune cinéphile qui écrit sur Synecdoche New York et se dit que c’est dommage que le film, à trop se prendre pour une synecdoque de la vie (??) devient totalement obscur dans la seconde partie, où existe une mise en abyme dans la mise en abyme de la mise en abyme. Le jeune cinéphile qui écrit sur le jeune cinéphile qui écrit sur le film se reconnaît alors dans le film et doit trouver quelqu’un d’autre pour écrire à sa place.
C’est l’histoire d’une jeune cinéphile qui écrit sur un(e) cinéphile qui écrit sur Synecdoche New York. Qui se dit que Charlie Kaufman est un scénariste extraordinaire mais qu’il devrait veiller à ne pas trop s'enfermer dans son univers sous peine de s'y retrouver seul...
Note : ***
Publié par Bastien à 00:08 0 commentaires
Libellés : ***, Années 2000
mercredi 8 juillet 2009
Alexandre Nevski (Александр Невский)

Camarade ! L’œuvre est venue de parler d’un cinéaste majeur ! D’un cinéaste incroyable ! Cinéphiles de tous les pays, unissez-vous !
Alexandre Nevski est ce qu’on appelle un héros : jeune prince et surtout militaire de génie, il a en effet réussi coup sur coup à vaincre les Suédois et les Allemands qui venaient envahir la Russie. Alors quand Staline a besoin de rassurer le peuple en 1938, devinez à quoi il pense ?
Car bien évidemment, c'est une oeuvre propagandiste en plein : comment au 13e siècle les Russes ont repoussés les vilains Teutons grâce à leur persévérance et, surtout, leur leader charismatique... Inutile de faire un dessin. Il paraît qu’Hitler n’aimait pas trop le film d’ailleurs… Eisenstein non plus d’ailleurs : étroitement surveillé, il dut aussi travailler avec des techniciens et des acteurs membres du parti qui, franchement, sont très moyens. Autres défauts à mes yeux : un sentimentalisme assez limite et des dialogues qui ne démontrent qu'une chose : qu'Eisenstein était plus à l'aise dans le muet.
Mais il serait bien stupide de croire que Eisenstein ne s’en sortirait pas ! La Grève, Le cuirassé Potemkine, Octobre avaient déjà démontrés qu’au sein même d’une œuvre de propagande, le cinéaste savait dépasser ses limites, appliquer ses théories sur le cinéma et rester un metteur en scène incroyable.
Ici, c’est la théorie du contrepoint qu’Eisenstein applique : contrepoints visuels (le blanc contre le noir, l’armure envahissante contre la cote de mailles, etc.) mais en plus, le cinéaste s'amuse à se moquer de son propre film, utilisant le contrepoint entre l'image et le son (la musique enjouée de Prokofiev qui dédramatise la scène de combat ou de mort).Ultime audace, il privilégie même l'individu à la masse (ce qui colle moyen avec le communisme...). Et si on échappe pas à des scènes assez bateau (les braves artisans refusant de s’écraser comme ces vils bourgeois), il subsiste de très grandes scènes, notamment les massacres des Teutons dans le village (les jets d’enfants dans le feu sont horribles) et la fameuse (et longue) scène de bataille sur la glace, qui contient en effet de grands moments.
C’est sans doute pour cette capacité à se détacher de la propagande au profit d’une véritable recherche (parfois expérimentale) qu’Eisenstein a su traverser les années sans perdre de son aura : ses films restent d’une étonnante modernité (surtout les muets à mes yeux) et sont de telles leçons de mise en scène que toute personne voulant comprendre le cinéma devrait connaître ses films sur le bout des doigts. Et ça, à part 2-3 autres cinéastes, c’est plutôt rare…
Note : ***
Publié par Bastien à 21:10 0 commentaires
Libellés : ***, Années 1940, Eisenstein S.M.
lundi 6 juillet 2009
Little Odessa
Dès son premier film, James Gray impose en effet à son récit un rythme lent, pour un film qui prend possession petit à petit du spectateur jusqu'a le laisser k.o. à la fin. Le cinéaste n’a cure alors de jouer sur l’action du film. Miraculeusement, il parvient à se détacher des deux modèles absolus du film de mafia, à savoir le lyrique et baroque Parrain et le virtuose et réaliste GoodFellas en proposant un autre type de récit, celui d’un petit caïd qui ne sera jamais grand, et de ses déboires familiaux.
Ce qui intéresse Gray, c’est bel et bien l’individu, tourmenté qui plus est, et sa relation avec son milieu. Ici donc les thèmes de Gray sont très présents : le poids de la famille (relation fraternelle + figure patriarcale), du Destin, les amours impossibles... Avec évidemment l'esthétique qui va avec, épurée et distinguée, proche de celle des grands films des seventies et des films indés des années 90 dont il fait partie.
A noter au passage un formidable casting inattendu : Tim Roth et Edward Furlong n’étaient pas d’immenses vedettes à l’époque, tout comme Vanessa Redgrave et Maximilian Schell n’étaient pas attendus dans de tels seconds rôles.
Le film, comme son antihéros, suit sa route écarté de tout et de tout le monde. James Gray est un immense cinéphile ayant digéré son savoir, et un artiste s’exprimant de manière simple, claire et efficace. Ce qui en fait de Little Odessa un film à part, vraiment, mais fascinant si on se laisse séduire un minimum.
Note : ****
Publié par Bastien à 17:09 0 commentaires
Libellés : ****, Années 1990, Gray James
jeudi 2 juillet 2009
Le château de l'araignée (Kumo no Sujō)
Le tour de force, c’est bien entendu la base du lien Occident-Orient du film : Shakespeare adapté façon Nô. Qu’est-ce que le Nô ? Eh bien c’est l’une des formes théâtrales les plus complexes et la plus japonaise qui soit (je renvois à Wikipédia pour toutes les précisions nécessaires : http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4). Ici, l’influence est particulièrement esthétique (sobriété des intérieurs) et portée sur le jeu des acteurs, leur gestuelle et surtout leurs expressions faciales qui évoquent les masques traditionnels du Nô. Celles de Toshiro Mifune viennent ainsi du masque samouraï ‘heita’.
Evidemment, les détracteurs diront « ouais mais le théâtre japonais ça va quoi, on ne le connaît pas alors on va pas comprendre le film ! ». Dites donc, je vous trouve bien pessimiste ! Car sans connaître le Nô ou même l’œuvre originale (MacBeth donc) de Shakespeare (et ainsi ne pas voir les petites subtilités, comme le remplacement des sorcières par un spectre unique), Le château de l’araignée reste un film à ne pas manquer.
Pourquoi ? Pour son ambiance extrêmement soignée, où la mort plane autant que le brouillard joue un rôle prépondérant dans le film. Pour la composition des plans de Kurosawa, toujours très soignée. Pour la tension qui va crescendo (fantastiques moments de meurtre du Shogun et d’hallucinations morbides). Pour des moments de bravoure comme seul Kurosawa savait en créer (magnifique mise à mort du personnage de Mifune, qui hantera longtemps les esprits).
Et puis pour Toshiro Mifune. Eh oui, je me répète mais ce type était tout simplement un acteur incroyable. Tout comme Akira Kurosawa est un réalisateur que l’on a trop oublié aujourd’hui, alors qu’il a réalisé bon nombre d’essentiels à tout cinéphile qui se respecte. Comme ce Château de l’araignée que je ne peux qu’encourager à voir.
Note : ****
Publié par Bastien à 15:16 1 commentaires
Libellés : ****, Années 1950, Kurosawa Akira